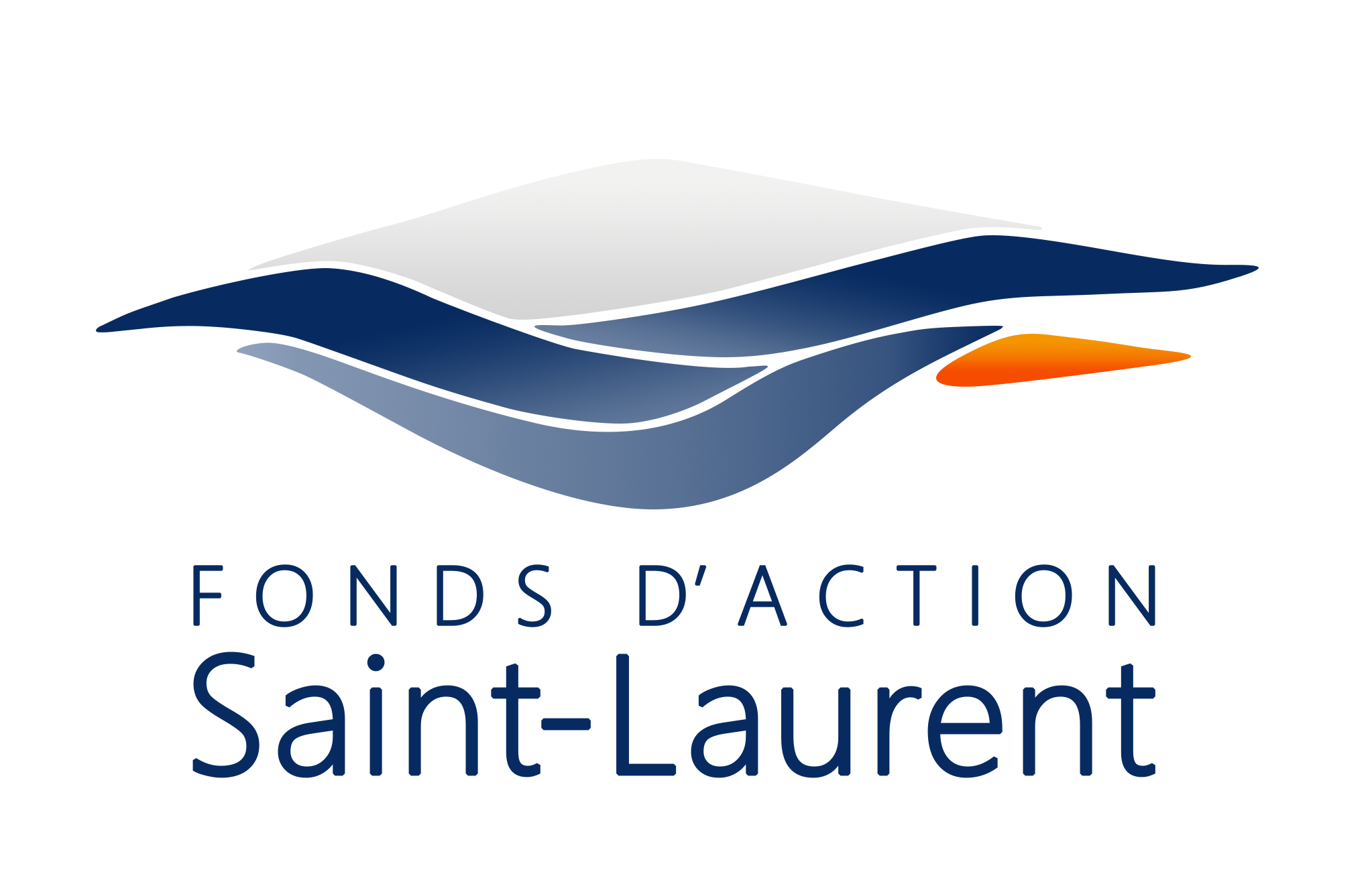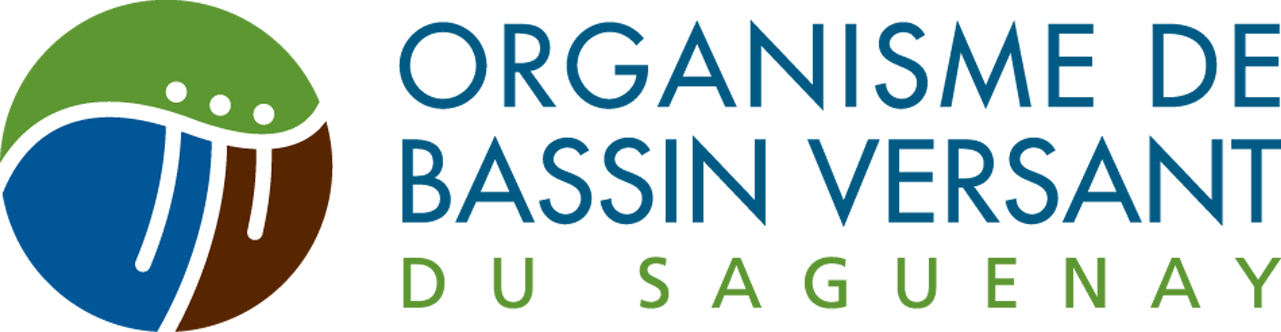Restauration des rives du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent - Section fjord
Un grand pas pour la santé du Saguenay : EURÊKO! lance un ambitieux projet de restauration des rives avec l’appui du Fonds d’Action Saint-Laurent
Saguenay, le 28 juillet 2025 — L’organisme environnemental EURÊKO! est fier d’annoncer le commencement officiel du projet Restauration des rives du Parc marin Saguenay-Saint-Laurent - Section fjord -, soutenu par un financement de 305 000$ du Fonds d’Action Saint-Laurent (FASL) dans le cadre de son Programme des Aires Marines Protégées (AMP), ainsi que le Gouvernement du Québec pour leur soutien accordé dans le cadre du Plan Nature.
Ce projet s’inscrit dans une volonté de restaurer des milieux naturels dégradés, améliorer la qualité des habitats riverains et sensibiliser la population aux bonnes pratiques en matière d’aménagement durable. À travers des actions concrètes, EURÊKO! souhaite contribuer à la résilience des écosystèmes riverains du Saguenay, tout en créant un lien fort entre les communautés et leur rivière.
Une approche en trois phases pour des résultats durables
Ce projet, déployé sur trois ans, vise à restaurer les rives de la rivière Saguenay dans l’Aire marine protégée. Il prévoit la plantation de 10 000 végétaux indigènes et l’aménagement de trois bandes riveraines modèles. Réalisé en partenariat avec une quinzaine d’acteurs communautaires, scientifiques et municipaux, il se déroulera en trois phases.
- Caractérisation des berges (2025)
En collaboration avec l’Organisme de bassin versant (OBV) du Saguenay, cette première phase vise à identifier les rives les plus dégradées, évaluer la qualité actuelle des bandes riveraines et prioriser les interventions. Cette analyse guidera les efforts de revégétalisation selon un protocole développé par la ZIP Saguenay-Charlevoix, en collaboration avec le Parc Marin.
- Revégétalisation et terrains modèles (2026)
La deuxième année verra la plantation de 10 000 végétaux indigènes sur des sites écologiquement dégradés et l’aménagement de trois terrains modèles, chacun accueillant environ 150 plants. Ces sites serviront à la démonstration et à la sensibilisation, avec des panneaux explicatifs et des activités participatives ouvertes au public, en partenariat avec l’OBVS.
- Suivi et ajustements (2027)
La dernière phase inclut l’inventaire des plantations et le remplacement des végétaux morts (jusqu’à 1 045 plants), pour maintenir un taux de survie d’au moins 90 %. Cela garantira la pérennité des aménagements et l'efficacité écologique du projet.
Pour en savoir davantage à propos du projet, écoutez l'entrevue avec la chargée de projet diffusée à Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/cest-jamais-pareil/segments/rattrapage/2138654/un-ambitieux-projet-restauration-rives
Pourquoi restaurer les bandes riveraines ?
Les bandes riveraines, ces zones de végétation situées entre un cours d’eau et les terres environnantes, jouent un rôle écologique fondamental. Elles :
- Filtrent les polluants et les sédiments avant qu’ils atteignent la rivière.
- Stabilisent les sols et préviennent l’érosion.
- Offrent un habitat essentiel à une multitude d’espèces animales et végétales.
- Régulent la température de l’eau, essentielle à la vie aquatique.
- Contribuent à la qualité de l’eau et à la résilience face aux changements climatiques.
- Maintien la valeur du paysage par son cachet naturel.
Ces dernières décennies, les bandes riveraines ont malheureusement été trop souvent dégradées par l’urbanisation, l’agriculture et l’entretien inadéquat. Il est impératif de redonner toute sa place à cette ceinture de sécurité végétale essentielle à nos lacs et rivières.
À propos du Fonds d’Action Saint-Laurent (FASL)
Le Fonds d’Action Saint-Laurent est une initiative environnementale d’envergure qui soutient des projets concrets visant la protection, la conservation et la mise en valeur de l’écosystème du Saint-Laurent et de ses affluents. À travers le Programme des Aires Marines Protégées, le FASL contribue à préserver les richesses naturelles du Québec tout en favorisant la mobilisation des communautés.